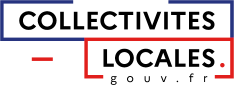/colo_struct_fina_loca/comp_coll/regi/anal_comp/anal_fonc.html
|
|||||||||||
Les produits et les charges de fonctionnement présentent les progressions les plus faibles de la décennie.
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 5,8 milliards d'euros (37,8 milliards de F) en 2000 (+2,2% par rapport à 1999). Après une évolution particulièrement favorable en 1999 (+5,9%), les produits de fonctionnement stagnent en 2000 (+0,5%). Ils s'établissent à 10,2 milliards d'euros (67 milliards de F). L'autofinancement s'améliorait d'année en année depuis 1996. En 2000, l'autofinancement dégagé en fonctionnement fléchit de 1,7%. Néanmoins, atteignant 4,4 milliards d'euros (29 milliards de F), il conserve un niveau élevé.
En dépense de fonctionnement, le budget se compose principalement de participations et de subventions. Cette structure de charges>est une spécificité des comptes régionaux. Si dans les communes et les départements, les charges de structure administrative (consommations externes et frais de personnel essentiellement) représentent la grande majorité des charges de fonctionnement, leur proportion est limitée à 13% dans les régions.
Les transferts versés en fonctionnement sous la forme de participations et de subventions, s’élèvent à 4,3 milliards d'euros (28,5 milliards de francs) en 2000. Bien qu'en progression de 2,9 % par rapport à 1999, ces dépenses de transfert marquent un ralentissement au regard des évolutions observées au cours de la dernière décennie (4).
(4) +10 % d’évolution moyenne par an depuis le début de la décennie
|
En 2000, l'évolution des participations se limite à 1,7%. Ces opérations bénéficient majoritairement aux organismes de formation professionnelle pour 1,96 milliard d'euros (12,9 milliards de F) et aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) pour 759 millions d'euros (4,97 milliards de F)). Ces participations sont destinées au financement de leurs charges d'exploitation.

Le parc immobilier des lycées a été fortement étendu par les régions depuis 1986. Si des constructions de bâtiments demeurent programmées dans plusieurs régions, les priorités sont désormais davantage orientées vers la sécurisation, la rénovation des structures (notamment les internats) et vers les équipements technologiques des établissements. Ces actions génèrent des frais de fonctionnement croissants mais à un rythme moins soutenu qu'auparavant.
En matière de formation professionnelle, les participations se maintiennent au même niveau depuis deux ans. Elles comprennent le financement des charges des organismes mais également la rémunération des stagiaires. Les dernières compétences transférées en la matière sont les actions de formation pré-qualifiante en faveur des jeunes de moins de 26 ans. Elles font l'objet de signatures de conventions pluriannuelles avec l'État.
Entre 1997 et 1999 les autres participations ont été largement abondées en raison de l'expérimentation du transfert de la compétence ferroviaire dans certaines régions (5) (+26% en moyenne sur ces trois années ). En 2000, la progression est plus modérée (+2,1%). Le transfert de compétence sera étendu en 2002 à l'ensemble des régions. Cette nouvelle compétence aura un impact sur les participations versées en fonctionnement, du même ordre que celui enregistré ces dernières années dans les sept régions ayant intégré le dispositif.
Les transferts versés par les régions en fonctionnement prennent également la forme de subventions. En progression de 8,2%, elles s'élèvent à 857 millions d'euros (5,6 milliards de F) en 2000. Les subventions peuvent financer des actions ciblées dans les domaines de compétence précités. Ces interventions permettent également aux régions de soutenir l'action d'associations ou d'entreprises pour contribuer au développement local, en particulier dans le domaine de l'aménagement du territoire, le développement économique, le sport ou la culture.
(5) Alsace, Centre, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes.
Les charges financières s'élèvent à 485 millions d'euros (3,2 milliards de F). Elles constituent le second poste de dépenses de fonctionnement par ordre d'importance. La baisse amorcée en 1997 s'accentue en 2000 (-14,9%). La politique de désendettement et de gestion active de la dette menée ces dernières années par les régions ont permis de réduire de nouveau les intérêts des emprunts de 6,6%.

La croissance des dépenses de personnel (+8%) demeure soutenue. Pour autant, les effets de ce poste de dépenses sur l'évolution d'ensemble des dépenses de fonctionnement des régions demeurent limités. Les charges de personnel s'élevant à 398 milliards d'euros en 2000 (2,6 milliards de F) ne représente que 7% des charges de fonctionnement en régions, au lieu de 48% en moyenne dans les communes.

En 2000, les achats et charges externes progressent de 17%. Ils s'élèvent à 363 millions d'euros (2,4 milliards de F), soit 6% des charges de fonctionnement des régions. Les achats et charges connaissent des évolutions contrastées d'une année sur l'autre liées à la diversité des composantes de ce poste. Ces achats comprennent notamment des acquisitions de matériels non immobilisés, les frais administratifs et les prestations de service. S'y ajoutent les frais d'entretien, de réparation et de location des biens mobiliers et immobiliers. Les charges comptabilisées à ce poste sont également constituées de remboursements de frais à d'autres collectivités. La proportion des achats et charges externes est toutefois limitée comparativement aux budgets des autres collectivités, notamment les départements, pour lesquels il s'agit du premier poste de dépense.

Les produits de fonctionnement se stabilisent (+0,5%).
De 1995 à 2000, la structure des produits de fonctionnement des régions a été modifiée par deux facteurs d'évolution :
- d'une part, l'augmentation des transferts reçus en contrepartie des attributions de compétences (formation professionnelle, transports, notamment) ;
- d'autre part, l'augmentation des attributions fiscales de compensation et de péréquation par suite de la réforme de la taxe professionnelle et de la suppression de la part régionale des droits de mutation.
Les produits de fonctionnement se stabilisent à 10,2 milliards d'euros (66,8 milliards de F). Les différentes composantes connaissent des évolutions contrastées

La fiscalité
Les produits de la fiscalité directe figurent parmi les plus dynamiques, avec une progression de 3,9%.
L'exercice 2000 est la deuxième année de mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle.
Celle-ci se traduit par une exonération supplémentaire de la part "salaires" des bases d'imposition (6). La réintégration des bases qui n'ouvrent plus droit à réduction pour embauche et investissement (REI) en 2000 et la croissance économique enregistrée en 1998 (7) ont permis aux de conserver in fine des bases de taxe professionnelle stables par rapport à 1999.
En 2000, le produit de la taxe d'habitation demeure inclus dans la fiscalité des régions.
La suppression de cette imposition intervenue après le vote des budgets locaux (8) a été appliquée la première année sous la forme d'un dégrèvement ; les régions ont donc perçu le produit qu'elles avaient voté initialement.
En 2001 elles recevront une dotation budgétaire de compensation évoluant comme la DGF.
(6) Article 44 de la loi de finances pour 1999.
(7) INSEE: +3,1% en volume - Exercice de référence pour la taxation.
(8) Article 11 de la loi du 13 juillet 2000 de finances rectificative (n°2000-656)
Le produit de la fiscalité directe varie de 27 à 84 euros par habitant selon les régions

La plupart des régions ont maintenu le taux des quatre taxes directes en 2000. Toutefois, trois régions les ont fortement augmentés. C'est pourquoi les taux moyens des quatre taxes progressent entre 2,3% et 3,9%.

Au total, en 2000, les régions ont perçu 3,9 milliards d'euros (25,9 milliards de F) au titre des impôts locaux.
La fiscalité indirecte connaît une évolution favorable de +3,3%.
En 1999, la suppression de la part régionale des droits de mutation a réduit sensiblement la part de la fiscalité indirecte dans l’ensemble des recettes fiscales. Cette fiscalité se compose désormais aux trois quarts du produit de la taxe sur les cartes grises. La croissance économique a favorisé les recettes de cette taxe, en hausse de 2,4% par rapport à 1999. Les autres taxes indirectes sont également dynamiques avec une progression de 8,8%.

Les attributions fiscales de compensation et de péréquation se composent de compensations (9) de fiscalité directe et du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. A partir de 1999 s'y est ajoutée une compensation spécifique versée au titre de la suppression de la TRADE (taxe régionale additionnelle aux droits de d'enregistrement). Ces recettes représentent en 2000 1,3 milliard d'euros (8,4 milliards de F) en 2000.
(9) compensations d'exonérations (ou diminutions) de fiscalité
Les transferts reçus en fonctionnement fléchissent de 5,5% en raison des versements plus importants que prévus intervenus en 1999. Ces décalages sont liés dans certaines régions au rythme de la réalisation des actions cofinancées par les fonds européens et à la mise en place des actions de formation professionnelle.
Au sein de ces transferts, la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) s'élève à 806 millions d'euros (5,3 milliards de F), en hausse de 0,8% par rapport à 1999. Elle est principalement destinée à financer des compétences exercées pour développer l’enseignement.
Seule la région Ile de France bénéficie de la Dotation Globale de Fonctionnement pour un montant de 82,5 millions d'euros (541 millions de F) en 2000. En baisse de 18%, elle est en voie d’extinction progressive (10).
Les régions d'Outre-mer et dix régions de métropole perçoivent des recettes au titre du Fonds de Correction des Déséquilibres Régionaux pour un montant total de 60 millions d'euros (396 millions de F). Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur recettes fiscales provenant de trois régions contributrices.
Le fonds de correction des déséquilibres régionaux

L’ensemble de ces trois dotations représente prés de 40% des transferts perçus par les régions.
Les autres transferts alloués aux régions en fonctionnement sont constitués pour l’essentiel de participations et subventions provenant de l’État, de l’Union Européenne ou d’autres collectivités.
Les participations de l'État ont connu une forte progression l'an passé (+10,3%). En 2000, elles fléchissent de 3,7%.
(10) La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 prévoit l’extinction progressive de cette DGF, au moyen d'une diminution de son montant de 18,3 millions d'euros (120 millions de F) par an.
Elles sont affectées essentiellement au financement des actions de formation professionnelle conduites par toutes les régions. Elles contribuent également au développement de la compétence ferroviaire qu'exercent sept régions expérimentatrices.
Les autres participations reçues en fonctionnement proviennent en grande partie de l'Union européenne et d'autres collectivités locales. Elles s'élèvent en 2000 à 195 millions d'euros (1,3 milliard de F), soit 30% de moins que l'an passé. D'importants versements au titre des fonds européens (essentiellement Fonds social européen) étaient intervenus en 1999. Les versements sont conditionnés par le rythme de réalisation des projets mis en place localement.
L’autofinancement dégagé par les régions fléchit légèrement (-1,7%).

Même si la croissance des charges de fonctionnement est ralentie en 2000, la stabilisation des produits de fonctionnement entraîne un léger repli (-1,7%) du niveau d'autofinancement des régions. Celui-ci demeure toutefois élevé. Il s'établit à 4,4 milliards d'euros (29 milliards de F) contre 4,5 milliards d'euros (29,5 milliards de F) en 1999.

L'autofinancement dégagé par les régions en section de fonctionnement représente 43,6% du total des produits de fonctionnement en 2000, contre 46,3% en 1996.
Les régions disposent de ce volume d'autofinancement pour financer les dépenses d'investissement.

Télécharger les documents
Méthodologie
-
Comptes individuels des régions
Descriptif des rubriques