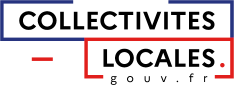/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm/lana_comp/anal_lequ.html
|
|||||||||||||||||
Analyse de l'équilibre financier
Le fonds de roulement est stable : 6,7 milliards d'euros
Les dettes à court terme se réduisent en 2001
La trésorerie des communes reste élevée
Le fonds de roulement est stable : 6,7 milliards d'euros
Les transferts de biens aux GFP donnent lieu à d'importantes moins-values de cession
Le fonds de roulement des communes s’élève à 6,7 milliards d’euros en 2001, soit un niveau quasiment identique à l’année précédente, du fait de l’équilibre entre les emplois et les ressources d’investis-sement.
Le fonds de roulement correspond à l’excédent des ressources stables sur les emplois stables du bilan. Il vise à compenser les décalages entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses.
Les ressources stables sont constituées des capitaux propres, des amortissements et provisions, et des dettes financières. Les emplois stables correspondent à l’actif immobilisé brut.
|
||||||||||||||
Les dépenses d’investissement direct engagées par les communes en 2001 à hauteur de 16,2 milliards d’euros sont venues abonder l’actif immobilisé brut. Toutefois, un certain nombre de biens ont dans le même temps été cédés ou transférés. L’actif immobilisé brut ne progresse ainsi que de 13 milliards d’euros en 2001, soit + 4,8%.
Les immobilisations corporelles enregistrent une hausse de 11,8 milliards d’euros, dont 5,3 milliards d’euros pour les constructions et 3 milliards d’euros pour les réseaux et installations de voirie.
Les immobilisations financières (5,3 milliards d’euros) progressent de 7,8%.
Les placements budgétaires des communes, qui atteignent 559 millions d’euros, augmentent de 9% par rapport à 2001.
Mais c’est surtout l’accroissement du montant des créances sur les groupements de collectivités qui explique la forte hausse des immobilisations financières en 2001.
Parallèlement, les capitaux propres se renforcent de 12,2 milliards d’euros, soit + 5,8% en 2001 grâce à l’intégration du résultat de l’exercice ainsi que des dotations et subventions d’investissement.
Toutefois, les cessions d’actifs intervenues en 2001 dans le cadre des transferts de compétences aux GFP se sont traduites par d’importantes moins-values de cession. En effet, s’agissant de l’exercice d’une même mission par des collectivité publiques, c’est le principe d’une cession à titre gratuit qui a été retenu ou, dans les cas où les emprunts destinés à financer en partie les biens transférés n’étaient pas encore remboursés en totalité, d'une cession à titre onéreux, à hauteur des emprunts restant à courir.
La ligne « Différences sur réalisations d’immobilisations» figurant au bilan 2001 fait ainsi apparaître une moins-value nette de 1,6 milliard d’euros qui matérialise la réduction des fonds propres concomitante au transfert d’actifs vers les GFP.
Après une année de stabilisation de la dette à moyen et long terme, les communes se désendettent à nouveau en 2001.
L’endettement s’établit en effet à 51,1 milliards d’euros contre 51,4 milliards d’euros en 2000, soit -0,5%.
Le ratio moyen d’endettement, exprimé en euros par habitant, passe de 834 à 829 euros.
D’une manière générale, ce ratio est proportionnel au poids démographique de la commune. Deux exceptions sont néanmoins à signaler : les communes des DOM ainsi que la ville de Paris où le ratio d’endettement est nettement plus faible que dans les communes de même catégorie.
Le ratio dette/capacité d’autofinancement (exprimé en nombre d’années) est stable : 5,3.
Dans le cadre du transfert de compétences aux GFP, certains actifs ont été transférés en pleine propriété par les communes aux groupements. La cession s'est faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à hauteur du montant des empru?nts restant à courir. Dans ce dernier cas, outre les actifs cédés, la dette a été transférée aux groupements, soit directement par débit du compte 16, soit indirectement, par constatation d'une créance à l'encontre des groupements à un compte d'immobilisation financière (voir supra).
La dette à moyen et long terme des communes se trouve donc partiellement surévaluée dans la mesure où le financement du remboursement du capital restant dû incombera, en fait, non plus à la commune mais au GFP.
Cet élément constitue, pour les années à venir, un facteur de baisse des charges financières.
Les dettes à court terme se réduisent en 2001
Le besoin en fonds de roulement des communes est négatif, ce qui signifie que les dettes à court terme sont supérieures aux créances à court terme. Le BFR s’analyse dès lors non pas comme un besoin mais comme une ressource en fonds de roulement.
Le besoin en fonds de roulement d’exploitation (B.F.R.E.) s’élève à -1,6 milliard d’euros en 2001, soit 358 millions de plus qu’en 2000.
Le B.F.R.E. est égal à la différence entre les créances d’exploitation et les dettes d’exploitation.
Le niveau des actifs d’exploitation régresse de 5% en 2001. En effet, les créances sur redevables et assimilés qui avaient sensiblement augmenté en 1999 et 2000 diminuent de 267 millions d’euros en 2001, soit -10,6%.
Parallèlement, les dettes d’exploitation qui n’avaient cessé d’augmenter depuis 1998 affichent une baisse de près de 10%.
En effet, les dettes sur achats marquent un recul de 479 millions d’euros, soit – 17,3%. Elles ne représentent plus que 2,3 milliards d’euros, soit le niveau le plus faible de la période 1997-2001.
De même, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes envers l’État et les collectivités publiques diminuent respectivement de 85 millions d’euros (-24,6%) et 162 millions d’euros (-27%).
Cette évolution s'explique sans doute en grande partie par la réduction de la durée de la journée complémentaire 2001 avant le passage à l'euro, les services ordonnateurs ayant limité au strict minimum les émissions de mandats au cours de cette période.
Le besoin en fonds de roulement hors exploitation (B.F.R.H.E.) s’établit à – 882 millions d’euros en 2001, contre –1 158 millions d’euros en 2000. Le B.F.R.H.E. qui est égal à la différence entre les créances diverses et les dettes diverses suit une évolution analogue au B.F.R.E. : les dettes sur fournisseurs d’immobilisations sont également en forte baisse (- 201 millions d’euros, soit -15,5%).
Le besoin en fonds de roulement qui est égal à la somme du B.F.R.E et du B.F.R.H.E. passe de -3,1 milliards d'euros en 2000 à - 2,5 milliards d'euros en 2001, soit une réduction de 634 millions d'euros de la ressource en fonds de roulement dont disposaient les communes.
La trésorerie des communes reste élevée
La trésorerie est égale à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.
Dans la mesure où le fonds de roulement est demeuré quasiment stable en 2001, la diminution de la ressource en fonds de roulement liée à la réduction des dettes à court terme, a été financée par prélèvement sur la trésorerie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
La trésorerie des communes s’établit ainsi à 9,1 milliard d’euros au 31 décembre 2001, en recul de 713 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
Le niveau de la trésorerie active (disponibilités, avances de trésorerie et valeurs mobilières de placement) diminue de 540 millions d’euros. Parallèlement, les concours bancaires courants enregistrent une hausse en fin d’année de 173 millions d’euros.
La trésorerie des communes tend à s'accroître en fin d'année du fait de la mobilisation de lignes de crédit généralement remboursées en début d'année N+1.
Le solde moyen journalier du compte au Trésor permet d'évaluer plus précisément le niveau de la trésorerie des communes.
Il s'élève en 2001 à 8,3 milliards d'euros, soit 206 millions de moins que l'année précédente et représente 39,5 jours de dépenses contre 41 jours en 2000.
Ce niveau reste toutefois très élevé. Il s'explique par le nombre de petites communes qui disposent d'une surface financière réduite et préfèrent donc cumuler des excédents plusieurs années de suite pour pouvoir investir, si nécessaire, sans avoir à augmenter la fiscalité ni recourir à l'emprunt.
Seules les grandes collectivités, qui disposent de services financiers, ont recours à une ou plusieurs lignes de crédit pour optimiser leur gestion de trésorerie.
L'intensité de la gestion active de la trésorerie croît proportionnellement à la taille des communes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||