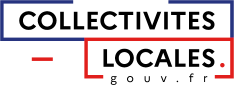/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm/lana_comp_3/anal_fonc.html
|
|||||||||||||||||
La hausse des charges est limitée à + 0,7% en 2003
Les produits de fonctionnement restent dynamiques : + 1,8%
L’autofinancement des communes se renforce
La hausse des charges est limitée à + 0,7% en 2003
Le total des charges de fonctionnement des communes atteint 56,5 milliards d'euros en 2003.
La dynamique intercommunale initiée par la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999, s’est poursuivie en 2003, les communes continuant à transférer certaines de leurs compétences à des groupements à fiscalité propre.
Ce mouvement a donné lieu à de nouveaux transferts d’actifs immobilisés aux groupements. Certains des biens transférés n’étant pas simplement mis à disposition des GFP mais cédés en pleine propriété, le niveau des charges exceptionnelles des communes s’en trouve majoré en conséquence. En évolution, l’analyse des charges réelles est donc plus significative que celle des charges totales.
En 2003, les communes ont réussi à contenir la hausse des charges réelles de fonctionnement à + 0,7% contre + 3,6% en 2002.
Trois raisons permettent d’expliquer cette évolution :
- le ralentissement de la croissance des achats et des charges de personnel
- la réduction des contingents et partici-pations obligatoires
- une nouvelle baisse des charges financières
(1) Les charges et les produits réels sont les charges et les produits pris en compte pour le calcul de la capacité d’autofinancement ; ils excluent notamment les dotations aux amortissements et les opérations liées à des cessions d’actif.
Les charges de personnel progressent moins vite qu’en 2002
Les charges de personnel qui pèsent pour près de la moitié dans le budget de fonctionnement des communes atteignent 26 milliards d'euros en 2003.
Le rythme de croissance de ces dépenses qui, malgré les transferts de personnel aux structures intercommunales s’était accéléré en 2002 (+ 4,9%), s’établit à + 2,4% seulement en 2003, soit le taux le plus faible de la période 1999-2003 durant laquelle les charges de personnel ont progressé en moyenne de 3,7% par an.
Cette décélération est plus marquée dans les villes de plus de 10 000 habitants que dans les petites communes où la croissance reste supérieure à 3%.

Les charges de personnel continuent de croître mécaniquement en raison de :
- l’effet en année pleine des revalorisations du point d’indice de la fonction publique intervenues en 2002 ;
- l’augmentation de 0,4 point de la cotisation employeur à la CNRACL ;
- l’impact du glissement vieillesse technicité (GVT).
Cette croissance est toutefois atténuée par la poursuite des transferts de personnel vers les structures intercommunales et par le recul des dépenses liées aux emplois d’insertion : les rémunérations versées à des emplois-jeunes chutent de près de 20% (387 millions d’euros en 2003) ; de même, le niveau des rémunérations attribuées à d’autres emplois d’insertion passe de 556 à 508 millions d’euros, soit un repli de 8,5%.
Les autres charges diminuent
Après avoir affiché une hausse de 5,1% en 2002 le poste « achats et charges externes » qui représente près d’un quart du total des charges de fonctionnement, se stabilise autour de 13 milliards d’euros (+ 0,4%).
Les principales dépenses (achats non stockés de matières et fournitures et dépenses d’entretien et réparation) qui avaient augmenté de 4,8% l’année précédente, se maintiennent quasiment au même niveau qu’en 2002.

De même, certaines catégories de charges (locations, primes d’assurance, frais de publicité, publications, relations publiques, frais postaux et de télécommunications) qui avaient fortement progressé voient leur croissance se ralentir en 2003. Une exception toutefois : les primes d’assurances enregistrent une nouvelle hausse de 10%.
Le tassement des achats et charges externes est visible dans toutes les strates de communes, la variation allant de - 0,3% dans les villes de 50 000 à 100 000 habitants à + 0,7% dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Les autres charges de gestion courante marquent un recul de 0,9% par rapport à l’année précédente.
Ce poste qui représente 18% du total des charges de fonctionnement s’élève en 2003 à 10,2 milliards d’euros. Il regroupe trois types de charges : les contingents et participations obligatoires, les subventions versées et les autres charges courantes non financières.
Le montant des contingents et participations obligatoires qui s’élève à 3,1 milliards d’euros accuse une baisse de 300 millions d’euros en 2003, soit - 9,1% qui s’explique par la diminution des contributions versées aux organismes de regroupement. En effet, les communes qui adhèrent à un syndicat versent à celui-ci une contribution ; la création de nouveaux GFP ou le développement des compétences des groupements déjà existants a entraîné la dissolution de certains syndicats dont les compétences sont désormais exercées par les GFP.
Les contributions aux organismes de regroupement (1,4 milliard d’euros en 2003) représentent près de la moitié des contingents et participations obligatoires versés par les communes. La contribution au service d’incendie s’élève à un peu plus de 900 millions d’euros, soit environ 30% du total.
Depuis la suppression des contingents communaux d’aide sociale, hormis quelques opérations résiduelles de régularisation, seule la ville de Paris (2) continue à enregistrer des dépenses au titre de l’aide sociale au profit du département, les autres départements percevant directement cette ressource par le biais de la DGF.
Comme en 2002 les communes ont versé un peu plus de 5 milliards d’euros de subventions de fonctionnement réparties entre des organismes de droit privé (plus de la moitié), les centres communaux d’action sociale et les caisses des écoles (près d’un tiers), les départements ainsi que d’autres collectivités et organismes publics.

Les communes ont également versé 626 millions d’euros de subventions d’équipement en 2003, soit 11% de plus qu’en 2002.

Le poids des charges financières qui avait diminué de 8,7% en 2002 s’allège à nouveau de 9,1% en 2003.
Au cours de la période 1999-2003 les charges financières des communes ont diminué en moyenne de 6,6% par an, permettant aux municipalités de dégager globalement une économie de 765 millions d’euros, soit près d’un quart du volume des charges financières de 1999.
Cette évolution, liée à un contexte de taux d’intérêts particulièrement favorable et à une gestion active de la dette, trouve également son origine dans la réduction de l’encours de dette à moyen et long terme consécutive au transfert d’une partie des actifs communaux et des emprunts y afférents aux structures intercommunales.
Toutes les strates de communes voient leurs charges financières diminuer, et dans les villes de plus de 50 000 habitants la baisse, bien qu’un peu moins forte qu’en 2002, dépasse néanmoins les 10%.
Analyse fonctionnelle
L'analyse des charges de fonctionnement peut être affinée dans les communes de plus de 3 500 habitants qui présentent leur budget à la fois par nature et par fonction.
Les services généraux totalisent 38,8% des crédits de fonctionnement, soit 15,7 milliards d’euros. Cette part est nettement moins élevée qu’en 2002 (43,6%) grâce à une meilleure ventilation des dépenses entre les différentes fonctions.
L’urbanisme est l’un des domaines de compétence privilégiés des communes : la fonction 8 « Aménagement et services urbains, environ-nement » est ainsi la plus fortement dotée (6,7 milliards d'euros, soit 16,5% du total des charges).
Les dépenses consacrées à l’entretien des espaces verts urbains par les communes de plus de 3 500 habitants s’élèvent à près de 1,4 milliard d’euros. Ces dépenses sont constituées aux deux-tiers par des charges de personnel. Les charges relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères comptabilisées dans le budget principal, s’élèvent à près d’1,2 milliard d’euros. Le poste « Voirie communale et routes » dépasse 1 milliard d’euros. Les enveloppes allouées à la propreté urbaine et à l’éclairage public s'élèvent chacune à plus de 500 millions d’euros. A noter que les dépenses consacrées à l’environnement (134 millions d’euros), en progression par rapport à 2003, restent comparativement plus faibles.
La fonction « Enseignement-formation » (12,6%) est dotée de 5,1 milliards d’euros dont plus de la moitié attribuée aux écoles primaires. L'action sociale (10,7%) occupe également une place essentielle dans le budget de fonctionnement des communes. Elle s’exprime notamment par le biais des CCAS et Caisses des Écoles qui ont été subventionnés par les communes à hauteur de 1,6 milliard d’euros.

(2) Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale et de santé du département (article L. 3413-2 du CGCT).
Les produits de fonctionnement restent dynamiques : + 1,8%
Le total des produits de fonctionnement des communes avoisine 65,2 milliards d'euros en 2003.
Les produits réels de fonctionnement qui avaient augmenté de 2,6% en 2002 voient leur croissance se réduire en 2003 mais restent dynamiques : +1,8%.
Les ressources fiscales continuent de progresser
Les communes bénéficient en 2003 d’une hausse de leurs ressources fiscales à peu près équivalente à celle de l’année précédente (+ 2,7% contre + 3% en 2002). Ces ressources atteignent ainsi près de 35 milliards d’euros.
Malgré l’adhésion de nouvelles communes à des groupements à TPU et la suppression de la part « salaires » dans l’assiette de cet impôt, 2003 étant la dernière année de la réforme, les communes maintiennent le produit des impôts locaux au même niveau que l’année précédente : 23,5 milliards d’euros (+0,3%).
La tendance à la baisse constatée depuis l’année 2000 s’interrompt en 2003, en raison notamment :
- de la revalorisation forfaitaire de 1,5% des valeurs locatives
- de l’intégration des bases de FRANCE TÉLÉCOM dans l’assiette de la TP
- de l’augmentation des taux d’imposition votés par certaines municipalités.
Comme les années précédentes, la perte de recette fiscale consécutive à la réforme donne lieu à une dotation de compensation, laquelle sera intégrée à la DGF à partir de 2004.
En 2003, 2 815 communes supplémentaires ayant perçu en 2002 un produit global de 1,1 milliard d'euros au titre de la taxe professionnelle, sont désormais soumises au régime de la taxe professionnelle unique (TPU).
Sur ces 2 815 communes, 1 312 n’appartenaient à aucun groupement fiscalisé en 2002, 1 448 communes appartenaient à une communauté de communes 4 taxes, et 55 communes à une communauté urbaine 4 taxes.

Depuis 1999, la réforme de la taxe professionnelle et l’extension du régime fiscal de la TPU ont bouleversé la structure de la fiscalité directe des communes. La taxe professionnelle qui représentait 44,6% du total des impositions directes en 1999 n’en représente plus que 21% en 2003 alors que la taxe sur le foncier bâti pèse désormais 41,8% et la taxe d’habitation 33,9% de ce total.

Ce constat qui s’applique aux produits fiscaux votés par les communes, doit toutefois être relativisé par le fait qu'une partie de la taxe professionnelle transférée aux EPCI est reversée aux communes membres.
Certes, le régime de la taxe professionnelle unique conduit les communes à transférer aux groupements l’intégralité des recettes de taxe professionnelle, les communes continuant de percevoir les seuls impôts ménages. Mais les groupements reversent aux communes une attribution de compensation égale au produit de la taxe professionnelle (perçu avant le passage en TPU), diminué du montant des charges transférées.
En outre, les communes peuvent, dans certains cas, bénéficier d’une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation prend notamment en compte la population, le potentiel fiscal et les charges des communes membres.
La croissance des ressources fiscales en 2003 est directement liée à la fiscalité reversée par les GFP aux communes qui affiche une nouvelle hausse de 21,6% pour atteindre 6,7 milliards d’euros.
La dotation de solidarité communautaire qui représente 11% de la fiscalité reversée, suit une progression analogue (+ 21,5%) ; elle passe en 2003 de 604 à 733 millions d’euros.
Sur les quelque 12 000 communes adhérant à un groupement à taxe professionnelle unique, près d’une commune sur trois a bénéficié de cette dotation de solidarité.
Les autres impôts et taxes enregistrent, à l’inverse, un recul de 6,8% consécutif à la baisse de près de 30% du produit de la TEOM ; la collecte et le traitement des ordures ménagères sont en effet de plus en plus souvent pris en charge par les GFP dans le cadre des transferts de compétence aux structures intercommunales. Le dynamisme de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière qui rapportent plus d’1,3 milliard d’euros en 2003 (soit + 8,6%) ne suffit pas à compenser le recul de la TEOM.
Le poids des ressources fiscales dans le total des produits de fonctionnement reste quasiment le même qu’en 2002 (53,4%).
La carte ci-après illustre néanmoins les disparités de ressources fiscales (en euros par habitant) sur le territoire national. Le niveau le plus élevé de ressources fiscales est concentré en région parisienne et dans le sud-est de la France, dans les régions Rhône-Alpes et PACA.

Les dotations de l’État augmentent de 1% en 2003
Le contrat de croissance et de solidarité institué par l’article 57 de la loi de finances pour 1999 pour la période 1999-2001 a été prorogé en 2003 comme en 2002. Les principaux concours de l’État aux collectivités locales continuent donc à progresser en fonction d’un indice composé du taux d’évolution des prix à la consommation (hors tabac) et d’une fraction du taux de croissance du PIB en volume (33% en 2003).
Les dotations de l’État aux communes s’élèvent à 12,4 milliards d’euros en 2003, en hausse de 1% par rapport à l’année précédente. Elles représentent 19% des produits de fonctionnement.
Les communes se voient ainsi attribuer 12 milliards d’euros au titre de la dotation globale de fonctionnement qui progresse de 1% par rapport à 2002. La dotation forfaitaire avoisine les 11 milliards d’euros. La dotation de solidarité urbaine passe de 592 à 615 millions d’euros ; la dotation de solidarité rurale (398 millions d’euros en 2003) comprend une part attribuée aux bourgs-centres, destinée à compenser les charges de centralité de ces communes, et une part destinée à la péréquation pour les petites communes ayant de faibles ressources fiscales.

Le montant des subventions et participations (12,4 milliards d’euros) diminue de 4% par rapport à 2002. Cette évolution s’explique par la sortie progressive du dispositif « emplois jeunes » qui se traduit en 2003 par une réduction de 25% des participations versées par l’État. Elle est à rapprocher de la baisse du volume des rémunérations attribuées par les communes à des emplois-jeunes (voir supra).
Les autres attributions (de péréquation et de compensation notamment) qui représentent un volume financier de près de 6 milliards d’euros sont quasiment stables en 2003. La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) qui constitue la variable d’ajustement de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État, s'élève à 3,3 milliards d'euros ; elle n’enregistre qu’une variation de + 0,6% par rapport à 2002.
Comme en 2002, la suppression de la part "salaires" dans l’assiette de la taxe professionnelle donne lieu à une compensation de 2,2 milliards d’euros.
Le niveau des autres produits de gestion courante qui s’élève à plus de 2,2 milliards d’euros, enregistre une progression de 10% en 2003. L’ampleur de cette variation est liée à la hausse des produits provenant des revenus des immeubles et des redevances versées par les fermiers et concessionnaires, mais aussi à l’augmentation de 26% des produits divers de gestion courante qui rapportent aux communes, en 2003, près de 83 millions d’euros supplémentaires. Le gonflement de ce poste peut s’expliquer, du moins en partie, par le reversement aux communes par les GFP, des intérêts des emprunts adossés à des biens mis à disposition des groupements et dont la charge de remboursement incombe désormais à ces derniers.
L’autofinancement des communes se renforce
La croissance modérée des charges conjuguée au dynamisme des produits permet aux communes de dégager en 2003 un résultat net de fonctionnement supérieur à 8,6 milliards d’euros, en hausse de 7,3%, rompant ainsi avec plusieurs années de stagnation ou de baisse de cet agrégat financier.
Comme l’illustre le graphique ci-dessus, même si, en structure, la part des impôts locaux votés par les communes a régressé au cours de la période 1999-2003, les ressources fiscales n’ont cessé d’augmenter depuis 1999 au rythme moyen de + 2% par an, et ce malgré la réforme de la taxe professionnelle.
L’évolution des produits courants financiers est extrêmement favorable aux communes en 2003 : à l’exception des « autres impôts et taxes », tous les postes progressent, y compris les impôts locaux. L’autofinancement se renforce ainsi de manière significative : il dépasse les 10 milliards d’euros (+ 8,4%).